Conseils pour éviter une parentalité surprotectrice
En tant que parents et grands-parents, nous voulons tous que les enfants soient en sécurité. Nous nous inquiétons pour eux et nous ne voulons pas qu’ils se blessent, qu’ils vivent des expériences blessantes ou même qu’ils aient à faire face au stress et à la tension. Mais, si nous ne faisons pas attention, notre quête de sécurité et d’absence de stress pour les enfants, en surprotégeant la parentalité, leur fera en réalité plus de mal, que de bien.
Comment ? Parce qu’être surprotecteur prive les enfants de l’opportunité de développer toutes les compétences dont ils ont besoin pour devenir un adulte fort et réussi. Cela a un effet négatif sur leur estime de soi, envoie le message aux enfants qu’ils sont incapables de gérer les choses eux-mêmes et leur apprend à douter de leurs propres décisions parce que nous leur disons toujours quoi faire et qu’on ne leur donne jamais l’occasion de choisir
La surprotection est un moyen d’améliorer la qualité de vie des enfants.
Etre surprotecteur apprend à les enfants à être craintifs, crée des enfants qui se transforment en adultes incapables de prendre des décisions, de se tenir sur leurs deux pieds ou de gérer le rejet. Ils grandissent sans avoir appris à évaluer, à gérer et à naviguer dans la vie
Les risques que nous leur faisons courir les exposent à la peur.
Les risques auxquels nous les exposons, parce que nous avons été surprotecteurs, sont en fait plus grands que ce dont nous les protégeons. Nous les laissons vulnérables, incapables de faire face aux défis plus importants que la vie leur lancera
C’est pourquoi nous les laissons vulnérables.
Alors, comment savoir si nous sommes surprotecteurs ?
Lorsque nous commençons à prendre en charge des choses que les enfants devraient gérer par eux-mêmes, Nous sommes surprotecteurs. Essayez de ne faire que rarement ou jamais quelque chose pour votre enfant qu’il peut faire lui-même. .
S’ils peuvent mettre leurs propres chaussures, laissez-les faire. S’ils peuvent se nourrir eux-mêmes, permettez-leur. MAIS… dans chaque situation, apprenez-leur d’abord. Apprenez-leur à utiliser la fourchette et la cuillère au préalable, par opposition à ce qu’ils utilisent leurs mains et jettent la nourriture par terre. Cela nous demandera d’être patients et de faire passer leur intérêt avant le nôtre.
Comment pouvons-nous éviter d’être surprotecteur ?
Premièrement, gardez l’objectif final en tête. .
En tant que parents, notre objectif est d’élever la prochaine génération de personnes responsables, capables, utiles et heureuses. C’est notre travail des préparer à fonctionner sans nous. Nous devons les aimer et les protéger. des aider à acquérir de la sagesse en grandissant. Et même si nous ne voulons jamais qu’ils ressentent de la douleur, de la déception ou de la frustration, ils vont en ressentir. Nous devons l’accepter, et au lieu d’essayer des empêcher de faire un jour l’expérience de la vraie vie, nous devons leur apprendre COMMENT gérer la vraie vie.
En tant que parents et grands-parents, nous devrions nous demander : » Est-ce que mes décisions aident mon enfant à développer les compétences nécessaires pour s’épanouir en tant qu’adulte ? »
Deuxièmement, nous devons évaluer les motivations.
Arrêtez-vous une minute et réfléchissez aux raisons pour lesquelles nous sommes surprotecteurs. Est-ce pour ne pas avoir à faire du travail supplémentaire ?
Parce que les parents étaient surprotecteurs ?
Parce que nous ne voulons pas que les enfants soient confrontés à un rejet comme nous l’avons ressenti lorsque nous étions plus jeunes ?
Parce que nous sommes impatients ?
Parce que nous sommes en quête de pouvoir ?
Parce que nous ne faisons pas confiance à notre enfant ?
Parce que nous ne connaissons pas la situation ?
Parce que nous ne connaissons pas assez notre enfant ?
Je sais que pour moi, il y a des moments où je deviens surprotecteur parce que je ne veux pas faire plus de travail. Par exemple, je surprotège et je micromanage les enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur pour les empêcher de se salir, afin de ne pas avoir à faire plus de lessive. Ou je ne laisse pas notre enfant de 3 ans monter tout seul dans son siège auto parce que je suis impatiente. Ou encore, je ne laisse pas les enfants plus âgés acheter leurs propres céréales, parce que je ne veux pas nettoyer leur désordre ou leur renversement (qui pourrait se produire parce qu’ils apprennent). Ce sont toutes des situations où je surprotège. Je fais pour eux des choses qu’ils sont capables de faire eux-mêmes. Ce ne sont pas des questions de sécurité, qui sont différentes.
Troisièmement, respectez le JEU !
Les jeux sont la clé de l’apprentissage.
Le jeu est la façon dont les enfants apprennent. Il constitue l’ultime salle d’école pour l’apprentissage et le développement. Les enfants sont faits pour courir, sauter, grimper et jouer. C’est par le jeu que les enfants se développent. Alors laissez-les jouer !
Laissez-les essayer de nouvelles choses, construire des forts, se salir et se disputer avec les voisins à propos d’un jeu. Laissez-les résoudre des problèmes sans que vous interveniez. Et apprenez-leur à l’avance ce qu’il faut faire s’ils jouent et qu’il y a un étranger, ou une nouvelle situation.
Il a en fait été constaté que les enfants tombent et se blessent MOINS lorsqu’on les laisse jouer seuls, qu’avec des parents qui leur disent constamment de faire attention et qui interviennent au moindre signe de danger.
Évitez de trop programmer les enfants, pour qu’ils aient le temps de jouer. Une, voire deux activités pour chaque enfant est amplement suffisante. Veillez à ce qu’il y ait du temps non structuré chaque jour et laissez-les résoudre leurs propres problèmes. Ne leur dites pas ce qu’ils doivent faire, mais encouragez-les plutôt à se divertir. Vous n’avez pas besoin de fournir un million de jouets et de jeux. Laissez-les explorer les feuilles et la terre, les rochers et les arbres.
Les enfants qui ne jouent pas assez, sont moins créatifs, plus susceptibles de lutter contre la dépression et les troubles mentaux, moins empathiques, plus susceptibles de lutter contre un trouble de l’anxiété, de lutter pour jouer avec d’autres enfants, résoudre des problèmes, prendre des décisions, etc..
Quatrièmement, enseignez-leur le comment et le pourquoi.
Les enfants ont besoin d’être informés.
Par exemple, les armes à feu et les piscines. Enseignez-leur la sécurité des armes à feu et apprenez-leur à nager et à être en sécurité au bord de la piscine. Parce qu’ils vont rencontrer les deux situations dans leur vie et vous ne pouvez pas toujours être là pour leur dire quoi faire. Enseignez-leur afin qu’ils puissent gérer les situations qu’ils ne manqueront pas de rencontrer.
La clé est des avertir (et de leur apprendre AVANT que les situations ne se produisent, au lieu de pendant). De cette façon, vous ne surprotégez pas. Par exemple, si vous allez vous promener au bord de la rivière, enseignez-leur avant les dangers de l’eau et comment être en sécurité, mais quand même explorer. PAS lorsqu’ils sont dans l’eau et que vous êtes sur la rive en train de leur crier de » revenir ici « , » ne fais pas ça « , » trop dangereux, reviens ici tout de suite « .
Renforcer l’autonomie par des défis graduels
Pour compléter les pistes déjà évoquées, pensez à introduire des petits défis progressifs qui stimulent la prise d’initiative sans mettre l’enfant en position d’échec total. Plutôt que d’enlever des obstacles, aménagez des situations où il peut expérimenter, corriger et recommencer : aménager un coin bricolage, confier des responsabilités simples lors des routines ou proposer des énigmes adaptées à son âge favorisent la mise en place de compétences exécutives telles que la planification, la mémoire de travail et le contrôle inhibiteur. L’usage régulier de rituels et de feedback descriptif (dire ce que l’enfant a réussi plutôt que le noter globalement) renforce sa confiance en ses capacités et développe la métacognition : il apprend à réfléchir sur sa manière d’agir et à ajuster ses stratégies. Introduire des conséquences naturelles et des risques calculés — par exemple laisser un enfant résoudre un conflit mineur avec un camarade — est souvent plus formateur que l’intervention immédiate du parent. Pour des ressources pratiques sur l’accompagnement progressif et la prévention des comportements excessivement protecteurs, consultez des infos sur www.risc.lu.
Enfin, valorisez les efforts et non seulement les résultats : le renforcement positif ciblé encourage la persévérance et la résilience, deux qualités essentielles pour affronter les défis de l’adolescence et de l’âge adulte. Observez et notez les petites victoires, adaptez la difficulté en fonction de la réponse de l’enfant, et pratiquez l’étayage : offrez de l’aide spécifique quand c’est nécessaire puis délestez-la progressivement. Ces approches favorisent une autonomie durable, une meilleure régulation émotionnelle et une curiosité soutenue, autant d’éléments qui contribuent au bien-être global et à la préparation à la vie en société.
Pour élargir les approches déjà évoquées, mettez en place des micro-expériences structurées qui valorisent l’initiative, l’auto-efficacité et la responsabilisation. Par exemple, proposez des petits projets collectifs adaptés à l’âge — s’occuper d’un coin du jardin, préparer une recette en autonomie, ou organiser un échange de jouets entre camarades — où l’enfant dispose d’une marge de manœuvre mais doit aussi assumer les conséquences de ses choix. Ces dispositifs stimulent la plasticité cognitive et développent des habiletés sociales : négociation, répartition des tâches, résolution de conflits et prise en charge d’un résultat imparfait. Ajoutez un rituel court de debrief (trois à cinq minutes) après chaque activité pour transformer l’erreur en ressource d’apprentissage, en favorisant l’auto-évaluation et le feedback descriptif plutôt que la critique globale. Des outils simples comme un journal de progrès, une grille d’évaluation ludique ou un « contrat de responsabilité » signé ensemble aident à clarifier les attentes, à mesurer les progrès et à encourager l’autodiscipline sans surcontrôle.
Enfin, élargissez l’horizon de l’enfant par des expériences d’engagement communautaire adaptées : participer à une action locale, préparer un petit projet solidaire ou intervenir dans une mini-commission de la classe offre un cadre sécurisé pour tester la prise de décision collective et la gestion des désaccords. Introduire des échelles de risque mesurées (ce qui est acceptable, ce qui demande surveillance, ce qui est interdit) aide l’enfant à calibrer son jugement et à développer un sens moral pragmatique. Combinez ces micro-responsabilités avec un étayage progressif — aide ciblée puis retrait graduel — pour renforcer la persévérance, la curiosité et la capacité d’adaptation. Ces démarches complètent l’éducation par le jeu et les routines familiales en cultivant un esprit d’initiative durable et une responsabilisation réelle, préparant l’enfant à des interactions sociales complexes et à la prise de décisions autonomes à l’adolescence et à l’âge adulte.
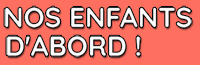











-0 Commentaire-